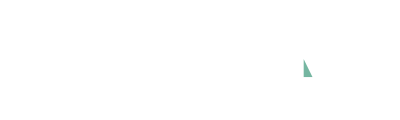François Lavallée, raconteur d’histoires
Entrevue avec le conteur François Lavallée, qui sera de passage à Mont-Laurier le 12 février.
Depuis 30 ans, François Lavallée fait du conte son quotidien. Le 12 février à l’Espace Théâtre, il fera voyager le public jusqu’au ruisseau près duquel il a grandi.
Parlez-nous de votre spectacle Le Ruisseau.
Ça se passe derrière chez nous, quand j’étais enfant. C’est une histoire faite de vécu, mais comme je le fais souvent dans mon métier, j’ose passer du réel à l’imaginaire. Ça parle surtout de la relation particulière que j’avais avec mon oncle, Normand, qui avait 10 ans de plus que moi. On regardait ensemble des films de cow-boy, on partait ensemble en vélo au bord du ruisseau. J’étais Dwayne, il était Mitchell, et parfois j’étais François et lui Normand. C’était à la fois mon oncle et mon héros. Le spectacle raconte cette relation-là avec un adulte qui était capable de partir dans l’imaginaire et qui était rempli de bonté (…) C’est un hommage aux adultes qui m’ont donné envie de grandir, et quand je repense à eux à 48 ans, qui soulagent ma peur de vieillir.
Qu’est-ce qui vous a amené à devenir conteur?
Jeune adulte, j’étais animateur et directeur de camp de vacances. Au bord du feu, le soir, on me demandait de raconter des histoires. J’ai été nommé conteur par les adolescents et les enfants, et ça fait 30 ans maintenant que j’en fais mon métier.
D’où tirez-vous l’inspiration pour vos contes?
Au départ, il y avait tout l’univers de la légende du conte québécois de ruse et d’astuces, les histoires de Ti-Jean, les légendes fantastiques du Québec, tout l’imaginaire qu’on retrouve en partie dans les camps de vacances. Rapidement, on m’a invité à aller en Europe pour raconter. J’ai fait une centaine de projets à l’international, entre autres en Afrique et en Roumanie. C’est sûr donc qu’il y a une partie de mon travail qui a été influencée (…) Dans mes voyages, j’ai retenu des rencontres que j’ai faites surtout des façons de raconter, des sensibilités plutôt que des contes en eux-mêmes. Par exemple, je ne raconterais pas un conte africain. J’aurais l’impression de faire la fameuse appropriation culturelle. Ça ne serait pas juste parce qu’il y a des symboles, des archétypes, des valeurs, des joies, des peines, des colères qui ne nous appartiennent pas. Même si les contes sont universels, ils sont profondément ancrés dans la culture.
Comment créez-vous le lien avec votre public afin qu’il se laisse transporter?
Je suis comme au bord d’un feu de camp. C’est là que j’amène le public chaque fois, peu importe l’histoire, et que je sois dans une grande salle de spectacle, dans une prison ou dans un centre communautaire. Mais c’est sûr qu’on ne raconte pas nos histoires de la même façon. Quand je commence en disant « Au bord du chemin de la vie, à la sortie du village qui marque le début du monde », ça ne sonne pas pareil sur une scène à Mont-Laurier que dans une prison.
Parvenir à faire voyager des personnes en détention, ce n’est pas rien.
J’ai parfois l’impression qu’on est tous pris dans nos prisons d’adultes. Prendre l’adulte et l’amener à l’aventure, c’est mon travail. On bascule ensemble dans un autre monde, dans un autre espace où il y a un autre ordre, une autre liberté (…) L’imaginaire est un outil qui doit toujours être bien aiguisé pour brasser les idées et penser à un monde qui pourrait être beau.
Quelle approche privilégiez-vous lors de la création d’un nouveau conte ?
J’ai toujours travaillé avec l’orature et la littérature, et je passe d’un à l’autre tout dépendant du projet. Ce que je trouve intéressant, c’est qu’avec l’un ou l’autre, le spectacle nous ramène toujours à une autre écriture : l’écriture de l’instant (…) C’est ça, l’art vivant. Ça se joue dans les silences.
Vous vous inspirez parfois de contes anciens. Comment les transposez-vous pour aborder des sujets actuels?
En vieillissant, y a des contes avec lesquels je trouve un plaisir fou tout à coup, comme ceux des frère Grimm. Ça peut permettre de soulever des questions actuelles, comme celui du genre, du rôle de la princesse, du chevalier et du roi. Ce sont des archétypes qui ont marqué notre imaginaire, mais comment est-ce qu’on peut raconter ça aujourd’hui avec élégance et délicatesse ? Comment être juste avec les méchants sans perdre l’essence de l’histoire? Comment activer ces personnages-là pour qu’ils résonnent et posent des questions au monde d’aujourd’hui? C’est toujours vivant, un vieux conte. C’est un prisme à questions.
Voir plus de : Actualités
Audience publique prévue pour le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement
C’est le 11 février que débutera l’audience publique au sujet du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement à la Régie intermunicipale …
Le fonds sociocommunautaire de 100 000 $ de la MRC des Laurentides reconduit
Ce fonds a pour but d’offrir un soutien principalement à la mission de l’organisme, mais aussi pour le démarrage d’un …
50 ans pour le sentier de motoneige Trans-Québec
En janvier 1975, après des années de travail acharné, le désormais légendaire motoneigiste Robert "Bob" Petit réalise son rêve de …