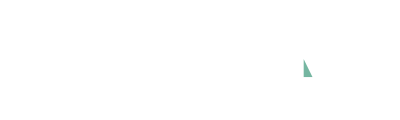Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides
Les services de santé dans les Hautes-Laurentides (3/5)
Par Suzanne Guénette.
En 1921, le gouvernement provincial met sur pied le Service de l’assistance publique qui encadre les soins donnés aux indigents. La même année, des efforts sont consentis au traitement de maladies vénériennes comme la gonorrhée et la syphilis dont, selon les estimations de l’époque, 8,5 % de la population est atteinte. En 1922, il ordonne l’exemption du secret professionnel aux médecins, certaines maladies devenant obligatoires à déclarer. En 1924, entre en vigueur la Loi relative à la tuberculose. Devant l’ampleur de la propagation de cette maladie, que l’on appelle le « fléau blanc », le gouvernement du Québec accepte de mettre en application un certain nombre des recommandations faites par la Commission royale sur la tuberculose instaurée en 1909-1910.
En 1926, l’Assemblée législative adopte la Loi sur la pasteurisation du lait qui s’inscrit dans la volonté gouvernementale de réduire les épidémies et le taux de mortalité infantile. La même année, grâce à l’invention du vaccin BCG contre la tuberculose, on entrevoit le jour où cette terrible maladie disparaîtra. De plus, le ministère de la Santé fédéral publie des mesures à prendre pour contrer d’autres maladies, dont certaines atteignent particulièrement les enfants.
Création de l’Unité sanitaire du comté de Labelle
En janvier 1931, le gouvernement du Québec accepte la demande du député Pierre Lortie, du comté de Labelle, d’ouvrir une Unité sanitaire à Mont-Laurier. Cet important système d’hygiène publique en milieu rural a pour mandat la prévention des maladies contagieuses par la vaccination et la mise sur pied d’un service de visites à domicile par des infirmières. C’est le véritable début de la médecine préventive au Québec. L’inauguration du nouveau service, sur la rue Mercier, a lieu le 7 janvier 1931, en présence d’Athanase David, responsable de ce service de santé dans le gouvernement Taschereau, et de Pierre Lortie.
Les années 1930, étapes importantes dans la médecine à Mont-Laurier
Le 14 janvier 1930, afin de répondre aux demandes d’hébergement pour les personnes âgées et les orphelins de son diocèse, Mgr Joseph-Eugène Limoges demande au ministre Alexandre Tachereau un octroi pour procéder à la transformation de l’ancien séminaire Saint-Joseph de Mont-Laurier, déménagé sur la colline Alix, en établissement capable d’accueillir ces types de clientèle. L’octroi accepté, en juillet 1931, les travaux de démolition de l’ancienne bâtisse sont achevés et on procède à la construction du futur immeuble, avec les meilleures pièces récupérées de l’ancienne structure du séminaire. Au mois de septembre suivant, les Sœurs Grises d’Ottawa acceptent la demande de Mgr Limoges de diriger l’hospice. Les premières religieuses arrivent le 7 juin 1932 et c’est Sœur Saint-Donatien qui prend charge de l’établissement.
Le 7 août 1932, les religieuses accueillent leur première pensionnaire et, à la fin du même mois, leurs deux premiers orphelins. Les personnes âgées et les orphelins y reçoivent des soins appropriés à leur condition physique grâce à un petit service d’infirmerie installé entre ses murs. Malheureusement, malgré le dévouement des Sœurs Grises et des médecins, les résidents de Mont-Laurier doivent encore être hospitalisés à Montréal pour y recevoir opérations, soins hospitaliers spécialisés ou interventions urgentes. Un wagon était réservé pour les malades sur le train qui les amenait dans les centres hospitaliers montréalais.
Voir plus de : Culture
Claudine Millaire honorée
À l’occasion du premier des trois concerts printaniers de la Chorale Harmonie de la Vallée de la Rouge, à l’église …
Gare de Mont-Laurier : Une consultation publique pour l’avenir du terrain
La MRC d’Antoine-Labelle souhaite entendre les citoyens de la région au sujet de l’avenir du terrain de la gare de …
Olivier Grenier-Bédard est lauréat du Prix Fichman en jazz
Lors du dernier concert de saison du Big Band de l’Université de Montréal avec Marcus Printup, le 16 avril, deux …